German ARCE ROSS. Paris, 2015.
À propos du livre de DIMITRIADIS, Yorgos, Psychogenèse et organogenèse en psychopathologie. Harmattan, Paris, 2013.
Psychoanalysis is not a neuroscience
If you ask me if psychoanalysis is a science or not, I can first say that psychoanalysis is not a neuroscience.
Psychoanalysis is not neuroscience because it has nothing to do with the neuronal or the behavioral. In this sense, psychoanalytic science can not be defined as a body of knowledge related to physiological functioning, or only in a very indirect or metaphorical way. And she is not a psychology of behavior, learning or cognition either. From this point of view, psychoanalysis can not be conceived either as a reeducative, normative or rehabilitative practice.
The knowledge that belongs to psychoanalytic science draws a very different field of neuronal and behavioral and have to do with the subject’s intimate and unconscious relations with sexuality, death, love, enjoyment or desire. These relationships are conceived as nescience, that is, as objects and territories functioning as non known acting.
La Psychanalyse n’est pas une neuroscience
Si vous me demandez si la psychanalyse est une science ou pas, je peux d’abord vous répondre que la psychanalyse n’est pas une neuroscience.
Elle n’est pas une neuroscience parce qu’elle n’a rien à voir avec le neuronal ni avec le comportemental. En ce sens, la science psychanalytique ne peut pas être définie comme un ensemble de connaissances liées au fonctionnement physiologique, ou alors de manière seulement très indirecte ou métaphorique. Et elle n’est pas non plus une psychologie du comportement, de l’apprentissage ou de la cognition. Partant de là, la psychanalyse ne peut pas non plus être conçue comme une pratique rééducative, normative ou réadaptative.
Les connaissances qui appartiennent à la science psychanalytique dessinent un champ très différent du neuronal et du comportemental et ont à voir avec les rapports intimes et inconscients du sujet avec la sexualité, la mort, l’amour, la jouissance ou le désir. Ces rapports se conçoivent en tant que nescience, c’est-à-dire en tant qu’objets et territoires fonctionnant comme du non su agissant.
Auto-résistances à la psychanalyse
De tous les temps, il y a eu des résistances à la psychanalyse qui, spontanément ou de façon argumentée, ont voulu la fin de l’analyse freudienne. Mais, de toutes les résistances à la psychanalyse, la plus dure et la plus malsaine n’est pas tout à fait celle de ses ennemis déclarés ni des gens qui ont peur de leur inconscient ni encore celle du patient, mais bien celle du psychanalyste lui-même.
À une époque, la psychanalyse a été vivement invitée à dévier de sa route par des idéologies de toute sorte, telles que la doctrine communiste, la révolution contre-culturelle, le mouvement féministe, etc., ou par des théories comme l’organo-dynamisme en psychiatrie voire par des psychologies éducatives et normalisantes tels que l’Ego Psychology d’Anna Freud. Néanmoins, toutes ces tentatives ont échoué dans la mesure où, parfois même à cause de ces résistances, la psychanalyse freudienne a continué à évoluer avec les apports de grands psychanalystes comme Jacques Lacan et tant d’autres post-lacaniens et non-lacaniens.
Aujourd’hui à nouveau, la psychanalyse, qu’elle soit freudienne, lacanienne ou indépendante, a deux grands dangers devant elle. Il s’agit de deux idéologies qui prétendent être “scientifiques” et qui, tout en attaquant de front la psychanalyse, aimeraient bien l’assimiler pour mieux la dominer en faisant disparaître la chose freudienne. Ces deux grandes idéologies, pseudo-scientifiques mais assez bien installées dans la mentalité de l’homme occidental du XXIème siècle, sont l’idéologie du genre et la psychologie cognitivo-comportementale.
L’idéologie du genre veut faire croire que les données biologiques, psychiques et inconscientes de la sexuation n’existent pas et que tout ce qui fonde les différences sexuelles peut être “déconstruit” et “réassigné” au gré des volontés, en fonction des caprices d’identification et selon une folie collective imposée au sujet. Méprisant la biologie comme opératrice fondamentale de la sexuation et déniant l’existence des différences sexuelles, l’idéologie du genre s’appuie sur une théorie socio-éducative pour développer une sociogenèse des questions psychiques et même biologiques.
La psychologie ou la psychiatrie cognitivo-comportementale, au contraire, veulent faire croire que le psychique n’est que secondaire au biologique et que la véritable thérapeutique de la psychopathologie passe essentiellement par une pharmaceutique appuyée cependant par des actes rééducatifs et réformateurs du comportement humain. Et, au mieux, les représentants de cette théorie, dite TCC, verraient la psychanalyse comme l’un de ces actes rééducatifs et réformateurs.
Bien qu’opposées quant à la causalité, on trouve dans ces deux idéologies (celle du genre et celle des TCC) la même théorie socio-éducative qui, ensemble avec le biologique ou non (selon que l’on se situe dans l’une ou dans l’autre), primerait, et de loin, sur la cause et la cure freudiennes.
Dans cette veine, le livre de Yorgos Dimitriadis tombe bien dans le deuxième de ces deux pièges, à savoir, celui de vouloir créer, malgré ses dénégations, une sorte de syncrétisme entre psychanalyse, psychopharmacologie, neurosciences et thérapies cognitivo-comportementales. En effet, avant même que le lecteur puisse s’exprimer, Dimitriadis se défend, tout seul, au moyen de dénégations, de vouloir dériver vers un syncrétisme organogénétique-psychosomatique dominant la causalité psychique. Mais, si on le lit bien entre les lignes, c’est-à-dire entre les balises de prévention qu’il met sur son chemin, c’est justement à quoi mène sa proposition !
Dans son livre, Yorgos Dimitriadis fait référence à nos travaux sur la question de l’intégration, ou plutôt sur l’association, de la psychiatrie, notamment celle classique et non biologique, dans le corpus épistémologique de la psychanalyse. Il dit notamment “dénoncer” « la tentation “impérialiste” de certains auteurs qui considèrent que nous pouvons nous contenter de l’épistémologie psychanalytique pour épuiser la questions des maladies mentales qui, du coup, ne seraient plus des maladies ». Et, à ce point, il cite nos travaux en appelant notre position de « programme fort » dans ce qui serait la défense de la psychanalyse et de la psychiatrie pour les maintenir en dehors du discours médical et de sa volonté de maîtrise (cf. pp. 256-257). Étant donné sa position, qui tente intégrer TCC, neurosciences, psychopharmacologie et psychanalyse, je trouve que Dimitriadis a tout à fait raison de faire une critique de nos théories. Car, de toute évidence, on se trouve l’un vis-à-vis de l’autre dans des positions antipodes, au moins en ce qui concerne cette question. Laquelle, à mon avis, est essentielle.
Je ne considère nullement que la psychanalyse ne doive pas maintenir un débat permanent avec les neurosciences, comme avec n’importe quel autre champ de la médecine en général, ou que le psychanalyste ne puisse pas recourir, de façon ponctuelle et mesurée, aux auxiliaires thérapeutiques de la psychiatrie biologique, tels que la pharmacologie par exemple. Car, d’après moi, la psychanalyse peut débattre avec les représentants des champs qui lui sont partiellement ou totalement hétérogènes, tels que l’épidémiologie, la sociologie, la philosophie, la linguistique, la poétique, la médecine générale, la psychologie, la psychiatrie, la politique, la topologie, les mathématiques, la logique, l’archéologie, l’anthropologie. Et ceci, sans l’intention de confondre ou de vouloir intégrer la psychanalyse dans l’une ou l’autre de ces connaissances ou sciences, qu’elles soient dites humaines ou exactes.
Plus précisément, mon propos sur la psychiatrie auquel fait référence Dimitriadis tient plutôt au fait qu’elle est désormais scindée en deux versions opposées, qu’on le veuille ou non. D’une part, il y a la psychiatrie classique qui, d’après moi, est très loin d’être une véritable branche de la médecine, et, d’autre part, il y a la psychiatrie biologique, laquelle est de plus en plus absorbée par une neurologie maquillée sous l’appellation de “neurosciences”.
Mon propos consiste donc à appeler pour que les connaissances de la psychiatrie classique soient intégrées par la psychanalyse, non pas pour que celle-ci devienne une superpsychiatrie, mais tout simplement parce que nous aurons besoin, un jour ou l’autre, de nous entendre autour d’une nosographie proprement psychanalytique. D’autant plus que la psychiatrie (surtout celle classique) risque de disparaître en tant que branche de la médecine, si ce n’est déjà fait.
Le Syncrétisme TCC-neurosciences-psychanalyse
Critiquant les travaux anti-biologistes de psychanalystes comme Alfredo Zenoni et Jacques-Alain Miller, Yorgos Dimitriadis prône la vieille théorie des déficits en ces termes : « nous pensons que les répercussions du langage sur la jouissance peuvent atteindre le corps, au point de provoquer des déficits, même sur le plan de sa neurobiologie, incluant la cognition, les humeurs, etc. » (p. 86). Et il appelle de ses voeux une conception, une théorisation, sur la survenue d’un déficit, dans la psychose, à partir de la théorie lacanienne ! L’auteur explique que, selon lui, on peut concevoir les dysfonctionnements de la chaîne signifiante, tels que sa gélification ou la forclusion du Nom-du-Père (et peut-être aussi bien les facteurs blancs ?), qui auraient comme base selon lui des processus neurophysiologiques, organiques donc, et à caractère déficitaire. La psychanalyse lacanienne ainsi conçue ne serait qu’une figuration superficielle des vrais processus déficitaires qui auraient lieu dans le cerveau.
Mais, comme Dimitriadis est également psychanalyste et pas seulement psychiatre biologique, pour ne pas faire mauvaise figure, il ne va pas jusqu’à suivre une stricte thèse organiciste dogmatique. Alors, son projet revient à refaire le monde de la psychopathologie avec un syncrétisme conjuguant inconscient freudien et psychologies cognitivo-comportementalistes.
Tout en se défendant de façon répétitive de syncrétisme, Dimitriadis passe à considérer « qu’il y a des rapprochements possibles entre les concepts psychanalytiques et les théories cognitivistes » (p. 216) et qu’il y a un « intérêt du dialogue entre la neurologie et la psychanalyse, et les sciences cognitives et la psychanalyse » (p. 245). S’appuyant sur le fait que l’affection ou la participation psychosomatique tend à abolir la contingence pour le sujet, au profit d’un automatisme, Dimitriadis considère que la gélification de la chaîne signifiante, par exemple, doit impliquer un passage de la logique du signifiant vers la logique neurophysiologique de l’embrasement, ou kindling (terme des neurosciences cognitivistes pour décrire les récidives automatiques déclenchés par des simples événements stressants, cf. p. 106). Dans ce cas, par exemple, la responsabilité du sujet, sa capacité à se connecter à son histoire de vie (inexistante ou non-importante, d’ailleurs, pour les cognitivistes), sa relation à l’Autre, les forces inconscientes, etc., ne joueraient aucun rôle. Mais seulement un “embrassement” de la machine cérébrale pour cause d’une simple habitude robotisée.
Dimitriadis vient ainsi à proposer un échange interdisciplinaire entre TCC et psychanalyse, dans la mesure où, par exemple, le filtrage de stimuli de Hemsley « pourrait être un biais pour concevoir une partie de la problématique qui régit la psychose de la part de la théorie psychanalytique, mais aussi de celle des neurosciences cognitives » (p. 269). On ne voit pas très bien de quelle théorie psychanalytique, qui ferait une telle place aux neurosciences cognitives, parle l’auteur. S’il ne s’agit pas de la neuropsychanalyse, que Dimitriadis dit ne pas cautionner, ni encore de la psychologie neuro-linguistique (PNL) ou de formations hybrides de ce genre, il ne peut s’agir que d’une psychanalyse encore à concevoir et qui combinerait de façon syncrétique des doctrines disparates, des dogmes opposés ou des champs hétérogènes et irréconciliables.
Nous savons très bien comment les religions syncrétiques produisent des formations fétichisées qui peuvent cependant être très populaires mais, faute de synthèse, reproduisent sans cesse et avec une force renouvelée l’aliénation mentale des participants. C’est le cas de syncrétismes religieux tels que l’Umbanda ou le Candomblé au Brésil, par exemple, lesquels combinent des croyances disparates appartenant aux rituels païens et animistes africains, mélangés de façon surprenante au spiritisme des indigènes autochtones ainsi qu’au christianisme des colonisateurs Portugais (cf. Roger Bastide, « Contribution à l’étude du syncrétisme fétichiste », 1946, Estudos Brasileiros, Perspectiva, Sao Paulo, 1973 ; Roger Bastide, « La Rencontre des Dieux Africains et des Esprits Indiens », Arch. 38, 1974, pp. 19-28 ; Allan Kardec, L’Évangile selon le Spiritisme, 1864). Dans le cas du syncrétisme religieux, aucune religion, aucune croyance, aucun rituel de base appartenant au mélange ainsi produit ne garde sa véritable signification ni son sens premier une fois déconnecté du contexte d’origine. En outre, ce sont les caractères fétichiste et trompeur qui s’imposent au sujet.
Heureusement, concernant le danger d’un syncrétisme TCC-neurosciences-psychanalyse et les auto-résistances à la psychanalyse, il n’y a pas de fatalité. Cela dépend de la position de l’analyste et de comment il travaille la demande au sens analytique. Car il ne s’agit pas toujours de répondre à ce que les patients croient demander. On n’est donc pas obligé de développer des “psychothérapies” qui ne serviraient à rien d’autre qu’à se préserver de l’inconscient. Pourtant, malheureusement c’est ce qui se passe chez les psychiatres avec leur utilisation de la psychopharmacologie, de l’ECT, de la luminothérapie, etc. C’est ce qui se passe aussi chez les psychologues, les psychiatres et quelques psychothérapeutes d’aujourd’hui lorsqu’ils dérivent vers les “thérapies” brèves, cognitivistes et comportementales.
Prenons rapidement trois situations cliniques où, à cause du syncrétisme TCC-neurosciences-psychanalyse, quelques résistances profondes à la psychanalyse pourraient s’exercer. Prenons donc, par exemple, le domaine des échecs scolaires, du symptôme obsessionnel et de la psychose maniaco-dépressive.
Échecs ou résistances scolaires
Le fait de gérer, prévenir, canaliser ou inverser l’échec scolaire d’un enfant est bien l’un des rôles des parents et, au-delà, des éducateurs et des enseignants. Si un enfant n’aime pas l’école et s’il n’est pas un génie désadapté au système scolaire, c’est qu’il y a un dysfonctionnement dans le noyau familial ou dans la relation parents-enfants ou encore quelque chose d’équivalent au sein des relations à l’intérieur de l’école. La “résistance scolaire” ou l’échec scolaire n’est pas en soi un symptôme psychique au sens analytique. L’échec scolaire ne serait que l’expression superficielle, c’est-à-dire l’un des signes les plus visibles d’un véritable symptôme (en grande partie inconscient) qui reste néanmoins à construire dans chaque cas. En outre, derrière le symptôme analytique, il y a la logique du fantasme à l’oeuvre pour l’enfant qui souffre de cette résistance à l’école.
Alors, si on veut l’aider, oui, on peut le guider pour lui permettre de reprendre les choses au niveau scolaire. Mais tout en sachant que ce n’est pas cela le réel problème. La vraie efficacité n’est pas de le faire aimer l’école coûte que coûte, mais d’utiliser ce constat, ou ce signe, comme voie d’accès pour le problème de fond qu’il présente sans le savoir, ou sans l’exprimer directement. Cela pourrait être configuré, par exemple, sous la forme d’une transmission très problématique du désir de savoir en fonction d’un secret familial ou d’autres éléments discrets et pas encore dénoués au niveau du couple parental, ou même d’un personnage particulier des générations précédentes.
Malheureusement, il y a une psychologie et une psychiatrie qui tentent de réduire cette problématique globale psychique à un ou deux signes extérieurs qui sont d’ailleurs arbitrairement construits : le déficit de l’attention ou l’hyperactivité de l’enfant, par exemple. Les TCC et la psychiatrie “neuroscientifique” définissent la résistance scolaire en purs termes de comportement ou de dysfonctionnement cognitif, comme si le problème se situait à cet endroit quantifiable. Ces “cliniciens” s’acharnent alors à faire disparaître les troubles qu’ils ont eux-mêmes décrits, construits et inventés. Le déficit de l’attention et l’hyperactivité de l’enfant, comportements mesurables, observables, quantifiables et surtout pharmacologiquement manipulables, ayant été ainsi maîtrisés, par voie de rééducation psychologique et par voie de médicaments, le problème est considéré résolu… Et les signes extérieurs de l’échec scolaire disparaissent sans que la source psychique, dont cet échec n’est que le symptôme, ne soit absolument pas élaborée.
En tout cas, nous voulons laisser bien clairement établi ici que dans les échecs ou dans les résistances scolaires il ne s’agit pas du tout de questions cognitives ni comportementales. Si on dérive vers le niveau des TCC, on risque de passer à côté du champ clinique auquel on essaie subtilement de faire entrer le patient. Si certaines personnes, par ignorance ou mal conseillées, demandent aujourd’hui des techniques rapides pour gommer un malaise, c’est à nous, psychanalystes, de leur aider à travailler les choses autrement et à leur construire une véritable demande et un véritable symptôme au sens analytique. C’est là la réelle efficacité de la clinique psychanalytique.
Du symptôme et de la causalité psychique dans la névrose obsessionnelle
Si on s’intéresse à la cure psychanalytique des névroses obsessionnelles, on se rend rapidement compte que le travail se fait en général suivant les thèmes analytiques suivants. Ces thèmes analytiques peuvent avoir des liens étroits avec ce que nous considérons comme étant la psychogénie, ou causalité psychique, véhiculée par la psychanalyse.
Un premier thème analytique, très large, est celui qui a trait à la préhistoire familiale du sujet selon au moins trois vecteurs. Nous avons ainsi la lignée maternelle, la lignée paternelle aussi bien que l’histoire du couple parental, qui précède la naissance et même la conception de l’enfant. Sans doute, nous avons là la prégnance du rôle de personnages ancestraux représentés par les grands-parents. Ces considérations nous amènent à un autre thème analytique, plus précis, déduit logiquement.
En effet, nous avons ensuite la conjoncture actuelle et concrète, en termes de vécu et de places intersubjectives, de la naissance ainsi que de la conception de l’enfant, comme aussi bien de la première année de vie. Un premier point de transmission se réalise à cet endroit, c’est-à-dire là où se trouvent les éléments nécessaires pour l’avènement de la métaphore paternelle et pour la possibilité du refoulement comme défense principale.
Dans un niveau presque permanent, nous avons un troisième thème analytique, qui a à voir avec la construction d’un récit de vie. Cela passe essentiellement, au début, par un troisième thème analytique et qui concerne les relations intersubjectives parents-enfant, mais aussi les relations entre l’enfant et ses camarades, entre l’enfant et l’école, la société, les codes sociaux, culturels, etc. Notons cependant que, dans cette liste, l’éducation proprement dite n’a qu’une part infime dans la structuration de la personnalité. Contrairement à ce que l’on peut penser, la causalité psychique des symptômes obsessionnels ou de la psychopathologie en général ne se situe pas dans l’éducation reçue. Mais dans les places qui sont assignées à l’enfant dans la trame familiale, et ceci non seulement depuis la grossesse mais avant même sa conception.
La causalité psychique serait bien plutôt, ou bien souvent, à chercher dans l’enfance et dans le vécu intime des deux parents. Car s’il y a un développement psychosexuel de l’enfant, il est construit non seulement en fonction du vécu lui-même de l’enfant, mais aussi en fonction des données psychiques inconscientes chez chacun des deux parents et chez le couple parental.
Dans le cas de la névrose obsessionnelle, les données psychiques inconscientes familiales, parentales et subjectives, tournent, en général, autour non pas vraiment de rituels assimilés à des comportements, mais ont à voir avec le symptôme analytique. En revanche, une partie des symptômes obsessionnels qu’on essaie de voir comme des “symptômes comportementaux”, tels que les attitudes d’indécision, certaines phobies obsédantes, des rituels concernant la sexualité, les obsessions sur la propreté, comme le besoin de se laver les mains de façon compulsive ou l’intolérance aux tâches sur les tissus qu’on porte, ne sont que des symptômes manifestes. Pour être efficace, il ne sert pas à grand chose de s’attaquer directement à ces “symptômes” par des mesures comportementales ou cognitives. Car lesdits “comportements obsessionnels”, auxquels s’attachent avec tant de passion volontaire les psys TCC, ne sont que la part visible, manifeste, sensible, du symptôme analytique et, à ce titre, restent en attente d’un véritable travail analytique.
Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire attention aux symptômes manifestes, dans la mesure où ils constituent la substitution signifiante à une autre problématique sous-jacente. Nous devons faire attention aux symptômes manifestes en tant qu’ils sont la porte d’entrée, le prétexte, la raison, la donnée concrète, pour parvenir à analyser la problématique inconsciente. Différemment des symptômes manifestes, les éléments analytiques qui constituent le symptôme obsessionnel sont, par exemple, le sentiment inconscient de culpabilité, le rapport particulier à la mort du père, la réaction conflictuelle au deuxième avènement de la sexualité (adolescence), et ainsi de suite.
Psychogénie de la psychose maniaco-dépressive
Les thèses organogénétiques aussi bien que celles syncrétiques (que l’on appelait à l’époque de Henri Ey du terme d’organodynamiques), supposent que la psychose maniaco-dépressive (PMD) ne serait que le versant psychodynamique d’un trouble bipolaire essentiellement organique ou endogène.
Contrairement à ces organogénétiques, organodynamiques, syncrétiques voire même psychosomatiques, je suis convaincu que lesdits “troubles bipolaires”, qu’ils soient considérés comme un « spectre » ou pas, ne sont que des simples signes extérieurs de la psychose maniaco-dépressive. Autrement dit, la PMD n’est pas “le versant psychodynamique” d’un “trouble bipolaire” qui serait organique ou psychosomatique.
D’ailleurs, il faudrait savoir si ce que la psychiatrie biologique et comportementaliste appelle aujourd’hui “trouble bipolaire” est juste une cyclothymie névrotique ou psychotique, une dysthymie schizophrénique ou la problématique circulaire, plutôt tripolaire dans ce cas, de la psychose maniaco-dépressive. Ou alors, s’il y a des troubles de l’humeur en dehors d’une configuration psychotique, il faudrait seulement parler de cyclothymie, dans le sens par exemple de Jean Delay.
En tant que psychanalystes, d’autant plus d’orientation lacanienne, nous savons que le problème de la PMD n’est pas biologique mais bien psychique et que la cure doit s’effectuer essentiellement en termes psychothérapeutiques et non psychopharmaceutiques. Pourtant, la psychiatrie d’aujourd’hui est malheureusement dominée par le double postulat de l’organicisme neuronal, d’un côté, et d’une psychologie cognitiviste et comportementale, d’un autre côté. Ce double postulat conduit à une rééducation psychique utilisant comme finalité la plus utile le traitement pharmacologique.
À ce titre, les TCC sont des pratiques très superficielles, qui ne s’attaquent qu’au “cosmétique” et que, en outre, reposent sur des postulats pseudo-scientifiques. Car le soi-disant “traitement” pharmacologique n’est pas, à vrai dire, un réel traitement. Il ne fait qu’utiliser des “drogues” manipulées par la médecine pour réguler, doser, diminuer, inhiber, désinhiber, calmer, impulser… des fonctions physiologiques, biochimiques et neuronales qui auraient été déséquilibrées par un processus qui reste encore inconnu par la science médicale. Et il demeure toujours inconnu, dans la mesure où la médecine le cherche à un endroit où il ne peut pas être. Alors, la psychiatrie biologique se contente de gérer les effets du processus psychopathologique sur le corps neuronal et biochimique.
La psychiatrie biologique devient alors une grande encyclopédie sur les effets organiques et physiologiques du psychique, comme si les connaissances dans ce champ si réduit des effets pouvait nous apprendre quelque chose sur la source du problème, ainsi que sur les moyens que cette source prend dans d’autres domaines très hétérogènes au somatique. Les TCC miroitent alors une “scientificité” auto-proclamée à partir de données statistiques et des protocoles expérimentaux qui les cantonnent à n’être que des pratiques auxiliaires et techniques d’une médecine qui tente de créer sa propre “psychopathologie” neuronale. Et, dans la mesure où les TCC se pensent scientifiques, parce qu’elles se plient à des statistiques ou à des concepts qu’elles croient manipuler et quantifier, elles produisent inévitablement une croyance impitoyable et pathétique.
Elles construisent un être humain robotisé, une sorte de machine physiologique et neuronale, cognitiviste et comportementale, qui n’a rien à voir avec le sujet de l’inconscient promu par la psychanalyse. Très rapidement, les TCC rencontrent leurs limites dans le fait que l’être humain est fondé justement par ce qui ne peut pas être quantifié ni rigoureusement localisé. Personne ne prétend que la sociologie, la philosophie, l’anthropologie, la politique, les arts…, devraient être quantifiés et devenir “scientifiques” selon le modèle des sciences physiques ou biologiques. Pourtant, en économie et en politique, par exemple, il y a aussi des crises dites « dépressives », des conflits, des “psychoses”, des “phobies”, etc. Mais, personne ne songe sérieusement à « traiter » ces problèmes par des médicaments, même si souvent les gens un peu en difficulté récurrent eux-mêmes à l’alcoolisme, aux psychotropes, aux drogues… pour fuir un peu leurs problèmes. Mais, évidemment, ce n’est pas cela une solution.
Les TCC non seulement sont superficielles dans les présupposées, dans la thérapeutique et dans les résultats, mais en plus elles sont dangereuses. Car elles ne prennent pas en compte tout le relief nécessaire pour constituer un sujet. Aussi, parce qu’elles viennent directement du conditionnement et rappellent la psychologie de la conscience et de la volonté qui primait en Union Soviétique par exemple.
Sujet de l’inconscient : science ou nescience ?
Ce qui fait bouger l’être humain, ou plus particulièrement ce qui est convenu d’appeler en psychanalyse le sujet de l’inconscient, est, non pas ce qui se sait, non pas la science ou la connaissance, mais bien plutôt la “nescience”, c’est-à-dire ce qui fuit ou ce qui est évanescent. On peut le trouver dans les trois domaines irréductibles du rapport au réel : non pas l’être mais le manque-à-être de la sexualité, le manque-à-être de la mort et le manque-à-être du langage. À savoir qu’on ne peut pas “guérir” de ces trois conditions-là : le sexe, la mort et le fait qu’on est des sujets parlés. La problématique psychique de base, posée pour tout un chacun, est qu’il faut que chacun de nous se débrouille, dans sa propre vie et selon son propre style, avec ces trois impossibles.
Cela dit, il peut y avoir des dysfonctionnements légers ou importants dans les modalités de configuration psychique qui produisent les réponses à ces trois impossibles-là. C’est à cet endroit que la psychopathologie peut exister et qu’une cure psychanalytique ou psychothérapeutique peut être très utile selon chaque cas.
Cependant, nous savons bien que la psychologie clinique et psychopathologique aussi bien que la psychiatrie non-biologique ne sont pas des véritables sciences exactes. Comme c’est le cas de la psychanalyse, elles ne sont des sciences que dans le sens des sciences politiques, des sciences sociologiques ou des sciences anthropologiques par exemple, lesquelles n’ont rien à voir avec le strictement mathématique ou le rigoureusement vérifiable, quantifiable et reproductible. Sauf, évidemment, si la psychologie ou la psychiatrie devenaient, respectivement, dépendantes des neurosciences ou de la neurologie. Mais dans ce cas-là, elle cesseraient automatiquement d’être des disciplines autonomes. Et l’on serait bien obligé de se tourner ailleurs pour construire des nouvelles disciplines totalement indépendantes de la neurologie et des neurosciences.
Cela dit, jusqu’à maintenant nous avons un grand problème linguistique dans nos disciplines du champ psychique. La psychologie clinique, la psychopathologie, la psychiatrie dynamique et la psychanalyse travaillent encore aujourd’hui avec des termes qui viennent de la médecine et, plus spécifiquement, de la neurologie, comme ce sont les termes de névrose, psychose, thérapeutique, diagnostic, pronostic, prévention, cure, etc.
Ainsi, depuis le XIXème siècle et après la période des “aliénations mentales”, nous appelons du terme de maladie mentale la psychose, tout simplement parce que nous n’avons pas d’autres mots en psychopathologie pour la nommer. Évidemment, cela prête à confusion avec la médecine mais les névroses, les psychoses, les perversions et les autres entités de la nouvelle psychopathologie, que nous sommes en train de décrire dans l’actualité, n’ont strictement plus rien à voir avec la médecine dont elles sont parties. Car l’étiologie de constructions pathologiques comme la psychose maniaco-dépressive est à trouver, non pas dans des modifications chimiques ou électriques du cerveau, non pas dans ce qui seraient des déficits de la machine physiologique, mais bien dans la transmission et la création de données psychiques appartenant aux liens précoces entre parents et enfants.
La Transmission trans-générationnelle
Si dans une famille, par exemple, le grand-père s’est suicidé ou si la grand-mère a été victime d’attouchements sexuels, pour ces raisons et pour d’autres connexions avec les complexes et les relations inconscientes familiales, leur enfant peut recevoir, ou hériter, directe ou indirectement une problématique lourde ou assez lourde. Et ceci, même s’il ne connaît pas le texte de vérité de ces événements. C’est le cas de secrets familiaux, avec ou sans événements factuels, par exemple. Car les secrets familiaux peuvent éventuellement exister en dehors ou au-delà d’événements historiques avérés ou factuels. En tout cas, cet enfant théorique, arrivé à l’âge adulte, peut devenir père ou mère tout en souffrant des effets de ces questions (suicide ou attouchements sexuels) qui n’ont rien à voir avec la physiologique, le neurologique ou le biologique.
Cet enfant donc, arrivé à l’âge adulte, pourra vivre les choses en ayant absorbé l’angoisse, la culpabilité et autres complexes hérités psychologiquement au travers d’une relation de grande proximité avec la part sombre des parents. Ensuite, lorsque cet enfant devenu adulte aura des enfants et que nous serons à la troisième génération donc, il pourra inconsciemment transmettre, sans l’avoir pourtant vécu directement, la problématique vécue par les parents. L’enfant nouveau-né de la troisième génération sera ainsi en connexion non seulement avec le parent adulte, mais aussi et surtout avec l’enfant que le parent a été dans la relation de grande proximité pathologique avec ses propres parents.
Si nous devons parfois parler, étudier, évoquer et analyser la vie psychique des grand-parents dans un cas donné, c’est parce que lorsque quelqu’un a des enfants il ressent inévitablement le retour de l’enfant qu’il a été avec ses propres parents. Et ceci, même si ses propres parents (les grands-parents) ne sont plus là.
Les facteurs psychiques seraient mieux à comprendre si l’on considère l’exemple suivant. Un sujet ne le sait pas mais, avant sa naissance, il y a eu un autre garçon né, son frère, qui est malheureusement mort. Le sujet ne le sait pas, mais ses parents, eux, le savent. Et ce fait suffit pour que la problématique soit psychiquement opératoire. Ils font immédiatement après un deuxième enfant, qui nait du même sexe que le précédent. Et ils lui donnent le même prénom que l’enfant mort. La place que ce deuxième enfant aura dans l’économie psychique familiale n’est ni physiologique, ni biologique, ni comportementale, ni cognitive. Elle se place ailleurs, dans le fait que le nouvel enfant rappelle, aux parents, au monde familial, le premier, mais sans l’être réellement. Les relations qui se tissent avec cet enfant peuvent équivaloir au cas où un sujet, ayant été frustré par une relation amoureuse précédente, transfère la problématique non résolue de la perte vis-à-vis du nouveau partenaire.
Prenons un autre exemple. Si un homme perd sa femme et son travail en même temps, il peut déclencher, pendant un temps, un état psychique particulier qui lui fait, en outre, avoir des troubles du sommeil, des angoisses et des maux de tête. Ces symptômes profondément psychiques peuvent prendre ou bien une allure ou bien une réelle expression somatique. Mais ce n’est pas vraiment celle-ci qui nous intéressera du début jusqu’à la fin de notre travail avec lui. Quelques médicaments peuvent l’aider à dormir, des anxiolytiques diminuer un peu la sensation physiologique de l’angoisse et une bonne aspirine, ou un autre analgésique, peut faire diminuer ou faire disparaître son mal de tête. Sauf que ni les calmants, ni les anxiolytiques ni l’analgésique ne peuvent résoudre le véritable problème psychique qui est de savoir pourquoi et comment tout cela lui est arrivé, et comment doit-il faire pour dépasser ces problèmes.
Sans aucun doute, ce que j’appelle les auxiliaires thérapeutiques, qui peuvent être pharmaceutiques ou électriques, comme l’ECT (électro-convulsivo-thérapie) par exemple, ne peuvent que calmer temporairement, ajourner, voiler… superficiellement les signes, tout en créant en plus, à part les effets collatéraux, une série incroyable d’effets ïatrogènes ou des effets indésirables. Mais, même sans l’existence de ces effets secondaires, la solution pour les problèmes psychiques graves (mélancolie, manie, paranoïa, schizophrénie) ne peut pas passer par le pharmaceutique ni par le biologique.
Les psychotropes, les anti-psychotiques, les neuroleptiques, les anxiolytiques, les anti-dépresseurs, ce sont seulement des drogues, médicalement contrôlées, pour inhiber les effets physiologiques des problèmes psychologiques. Mais ils ne sont pas la solution. En revanche, plusieurs psychanalystes observons que des patients psychotiques stabilisés par la psychothérapie psychanalytique cessent totalement ou diminuent considérablement, avec le temps, tout « traitement » pharmaceutique et vivent très bien, à condition d’effectuer une cure analytique adéquate et assez longue, il faut bien le dire.
Ce qui est curieux c’est que la psychothérapie et la psychanalyse produisent des modifications essentielles de la personnalité et du destin de vie d’un sujet, souvent en incluant des modifications substantielles du corps et du somatique. Étudier ces modifications corporelles et somatiques peut être très intéressant pour la médecine et pour la culture générale, mais cela ne nous apportera rien, ou presque rien, à l’exercice thérapeutique ou psychanalytique.
Si une collaboration inter-disciplinaire peut s’avérer possible et utile pour la connaissance globale de l’être humain, en aucun cas une fusion ou un syncrétisme entre ces deux disciplines si divergentes, la neuroscience et la psychanalyse, ne serait ni utile ni vraiment possible.
German ARCE ROSS. Paris, 2015.
Copyright © 2015 German ARCE ROSS. All Rights Reserved.
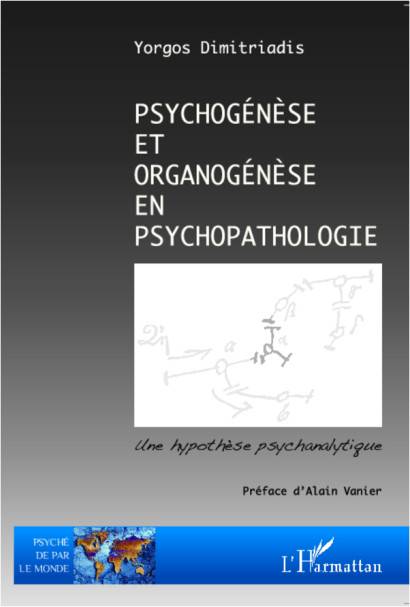
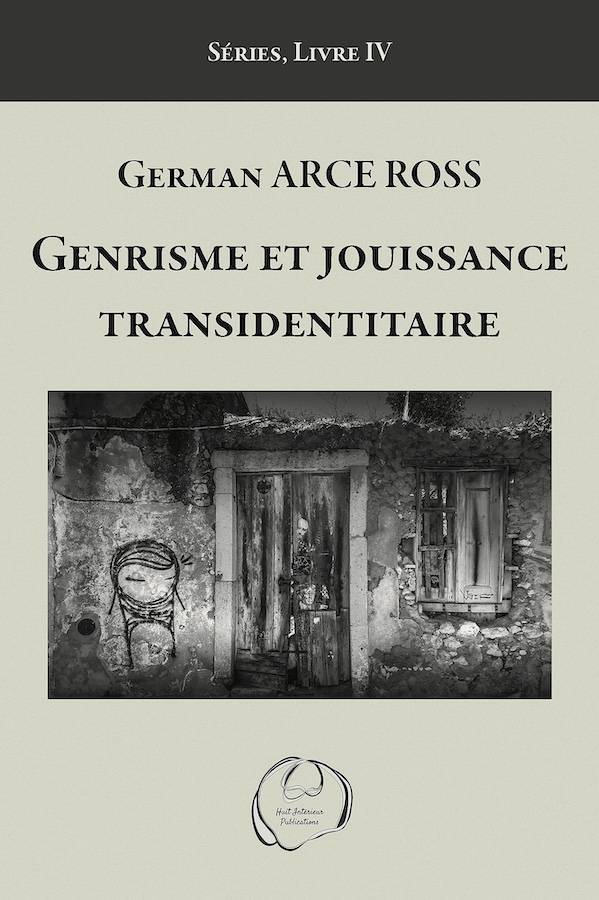
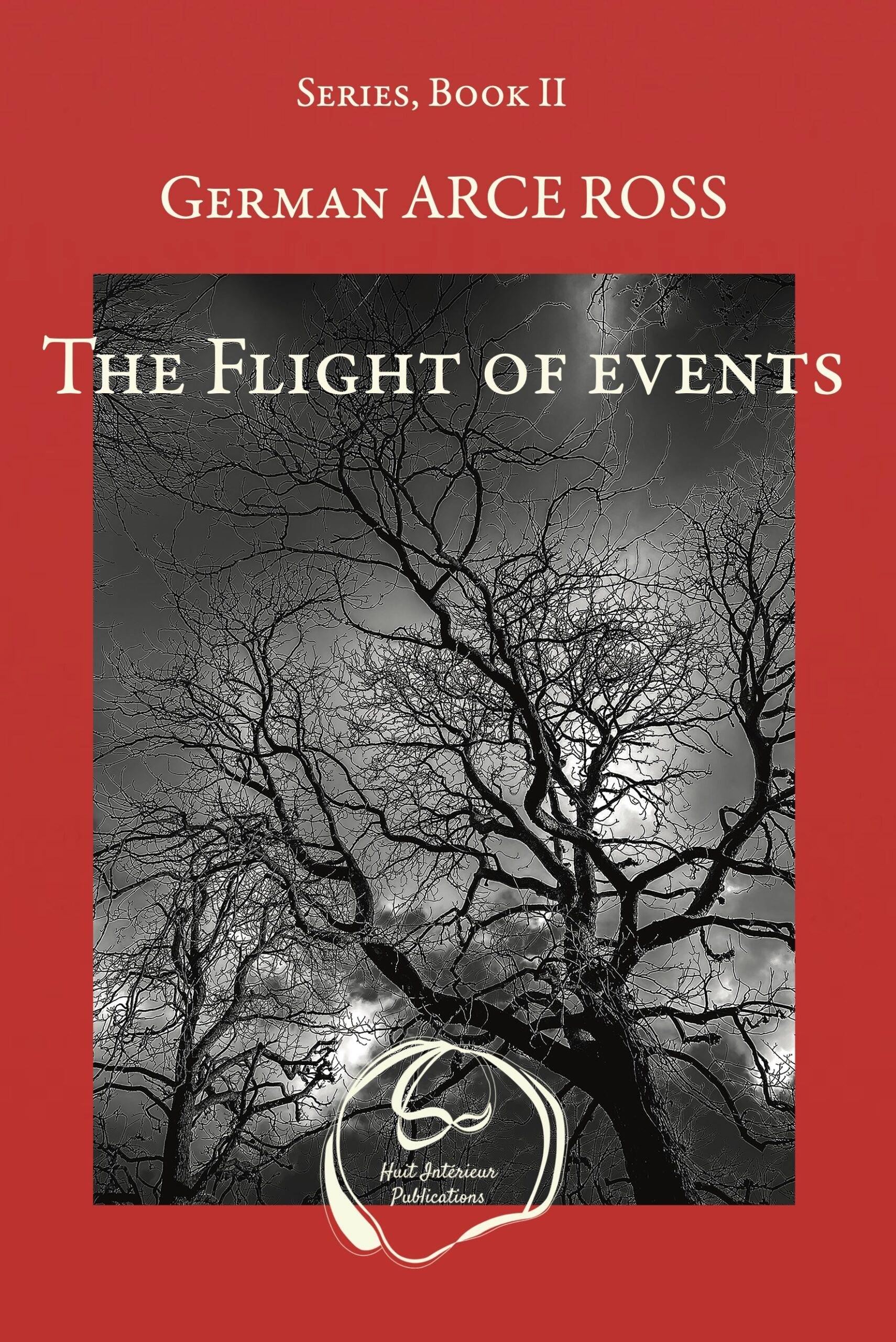
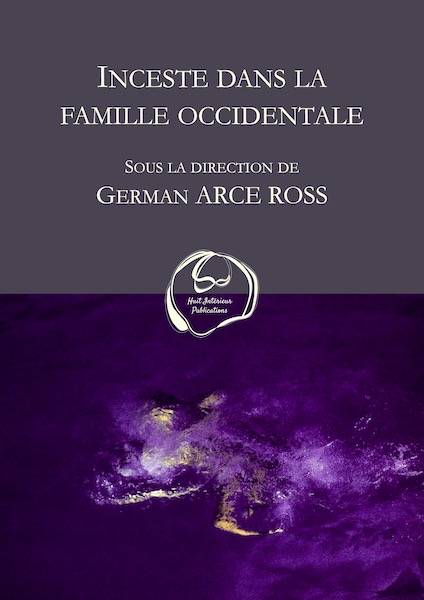
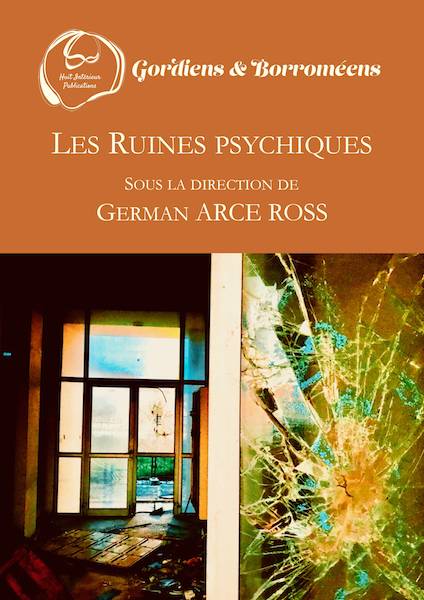
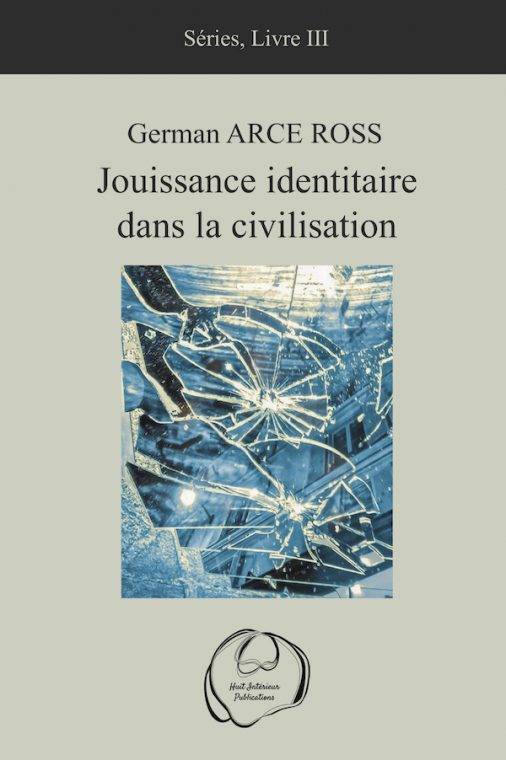

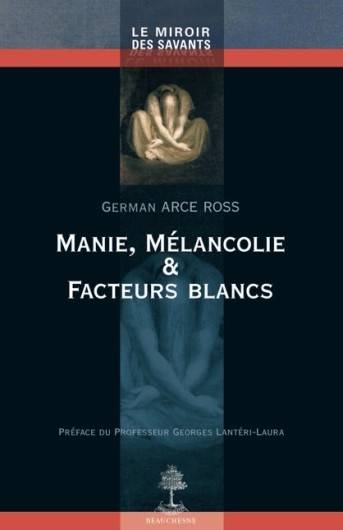

6 Pingbacks